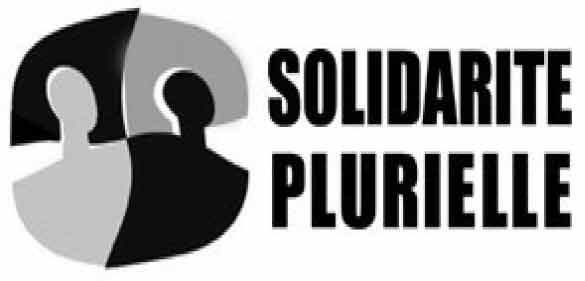Proposition de contribution au séminaire de Dakar
Solidarité Plurielle forme en partenariat avec l’Entss, des éducateurs d’enfants déficients intellectuels. Cette activité a démarré en 2006 en Mauritanie, elle s’est poursuivie au Sénégal de 2008 à 2011.
C’est depuis cette année là qu’une convention de partenariat existe avec l’Entss pour la mise en œuvre de ce dispositif de formation.
Il comporte :
- 4 semaines de théorie
- 4 semaines de stage pratique
- une dernière partie qui consiste à produire un dossier écrit pour chaque stagiaire. Ce dossier comporte un rapport de formation théorique, un rapport de stage, ainsi qu’une étude de cas. Ce dispositif s’étale sur une période de 9 mois.
Depuis 2011, une cession de formation est réalisée chaque année. C’est ainsi que 72 personnes faisant fonction d’éducateurs auprès d enfants déficients intellectuels, ont été ainsi formées.
Notre parti pris initial a été de nous adresser à des personnes sans qualification mais avec un niveau scolaire permettant l’expression, la compréhension, la lecture et l’écriture en français. Nous avons constaté que ces personnes, envoyées par leur structure employeur, ont pour un tiers d’entre elles, un niveau BFM… Un autre tiers a un niveau bac… Un dernier tiers bac +3 ou un diplôme professionnel du secteur éducatif ou médico-social. La moyenne d’âge de ces stagiaires se situe entre 37-38 ans, la plus jeune ayant 23 ans et la plus âgée 60 ans, dont 60% de femmes et 40% d’hommes.
Au fil des années, nous avons fait le constat des difficultés qu’ont ces stagiaires de compréhension du contenu des apports théoriques. Ces difficultés se sont révélées tout particulièrement aiguës dans la production des écrits du dossier de validation.
Ce phénomène nous a interpellés depuis la mise en oeuvre de cette action, c’est une sorte de hiatus dans notre dispositif de formation, écart entre ce qui est attendu et ce qui se produit effectivement.

Notre contribution à ce séminaire va se décliner par une réflexion sur deux aspects de ces difficultés rencontrées :
Le premier est celui de la question de la langue de formation et des difficultés de compréhension des aspects théoriques.
Notre langue de formation est le français. En Mauritanie, là où nous avons commencé cette activité, la langue officielle et la langue d’enseignement sont l’arabe. Nous avons eu de fortes pressions pour que nous fassions cette formation dans les 2 langues.
Nous avons maintenu notre cap, tout en acceptant des stagiaires « arabisants ».
Au Sénégal, la langue officielle et la langue d’enseignement sont le français. Le langage courant est cependant le wolof. Il est parmi les cinq autres langues, celui qui est pratiqué par 80 % de la population.
Nous avons pris le parti d’accepter que le wolof puisse être une langue utilisée dans la formation par les professionnels sénégalais intervenants. C’était quelques fois parfaitement justifié pour aborder des subtilités concernant des concepts culturels purement locaux.
En effet, lorsque l’on aborde les différentes pathologies et déficiences, certaines ont des résonances plus spécifiques dans la langue locale.
A. Zampleni et J. Rabain montrent comment une culture, construit et décrit, utilise et explique, une entité pathologique par les moyens de ses propres signifiants. Chez les Wolof et les Lebou du Sénégal, comme partout ailleurs en Afrique, la maladie mentale n’est pas considérée comme un phénomène naturel. La classification traditionnelle des troubles mentaux constitue une étiologie d’ordre culturel organisée autour de deux axes principaux :
- l’action des esprits : l’esprit introduit par l’Islam ou les esprits ancestraux traditionnels
- l’action des hommes : sorcellerie, envoutement, « maraboutage ».
La description des syndromes et des symptômes occupe une place mineure, elle est très peu systématisée. Le consensus collectif qui se crée autour de l’interprétation de la maladie, le diagnostic du guérisseur ou du marabout, attribuent une place signifiante au malade dans un système culturel formé par des unités de représentations : exemple on dit d’un enfant « nit ku bon » (enfant qui n’appartient pas au monde des humains, mais celui des ancêtres) ceci constitue une telle unité de représentation.
L’usage du wolof est tout aussi pertinent concernant les représentations sociales pour aborder le travail avec les parents, notamment dans la survenue de l’enfant handicapé au sein de la famille.
Pour améliorer la compréhension des apports théoriques en français, nous avons adapté notre pédagogie. Nous avons réparti les stagiaires de chaque promotion en plusieurs groupes, de 3 ou 4 personnes. Ils sont appelés, groupe cursus. Chaque groupe élabore une synthèse d’un apport théorique par écrit et le soumet par la suite oralement à l’ensemble de la promotion, pour discussion et validation collective. L’ensemble des apports théoriques est ainsi assimilé et restitué par ces groupes cursus. C’est ainsi qu’à l’issue de la partie théorique, chaque stagiaire bénéficie de l’ensemble de ces synthèses analysées et comprises sous forme écrite.
Pour faciliter la production écrite, nous avons instauré des ateliers d’écriture selon les préconisations de François Bon ; la pédagogie ludique utilisée n’est pas à visée utilitaire. Il s’agit par le biais du jeu, de donner le goût de lire, le plaisir de la lecture et de l’écriture.
Le second est la question du rapport au temps en Afrique et son incidence dans la réalisation du projet de formation.
Les difficultés observées concernent le respect des engagements des échéances, l’anticipation et la projection dans le temps. En effet, les stagiaires qui respectent les échéances à l’issue des 9 mois du cycle de la formation pour rendre leur production écrite, sont l’exception. Le fait de rendre cette production, permet alors le passage devant un jury et la validation de la formation.
Les 3/4 des stagiaires rendent leur dossier avec 6 à 9 mois de retard en moyenne, pour certains voir 18 à 24 mois après la date d’échéance.
Mr Bon Aventure Mve-Ondo, nous offre des pistes de réflexions pour prendre en compte ce hiatus, cet écart entre ce qui est attendu et ce qui se produit.
Les mythes africains nous révèlent, que non seulement il y a lieu de distinguer le temps sacré (originaire) et le temps profane (celui de la déchéance), mais encore le temps n’est ni tout à fait objectif ni tout à fait disponible, car relié tout entier aux puissances invisibles.
On comprend pourquoi une telle conception du temps et de la prédestination, implique que la notion de projet doit être maniée avec la plus extrême circonspection, car ici la déclaration d’intention et la supputation sur l’avenir, sont des attitudes dangereuses. Anticiper un événement heureux risque d’empêcher sa réalisation, tandis qu’anticiper un événement malheureux risque de provoquer sa réalisation.
Cela explique la nécessité de repenser les catégories et les concepts pour mieux comprendre les difficultés que traverse un continent écartelé entre ses traditions et la modernité occidentale.
S’agissant du temps, les sociétés traditionnelles opèrent un blocage de la dimension temporelle qui s’inscrit dans une logique sociale parfaitement cohérente, à savoir les choses ne changent pas, le monde est comme il est de tout temps. Si le changement doit se faire, celui-ci doit être lent, involontaire et inconscient. Trois termes qui opposent les sociétés traditionnelles aux sociétés contemporaines. La conséquence consacrée par l’obéissance aux ancêtres, c’est le lien indéfectible entre les ancêtres et les vivants. Tout le reste n’est qu‘accident.
Rappelons qu’il y a pour l’humanité, deux façons de traverser le temps :
La civilisation développe un certain sens du temps, qui est basé sur la notion d’accumulation et de progrès, tandis que la façon dont un peuple développe sa culture repose sur une sorte de loi de fidélité et de création. Autrement dit une culture meurt quand elle n’est pas renouvelée, recrée.
La création échappe à toute planification, à toute prévision, à toute décision d’un état ou d’un parti.
La loi tragique de la création d’une culture ne se fonde pas sur l’accumulation tranquille des outils qui la définissent comme une civilisation, mais dans l’essentiel de son interrogation première, qui est éducation à la pensée critique.
Nous nous sommes adaptés à ce phénomène de quasi impossibilité de respecter les échéances prévues, nous avons accepté ces entorses à la règle. Ces entorses étant largement majoritaires, elles tendent à devenir la norme.
C’est ainsi que la validation du parcours de formation, après le dépôt du dossier écrit par la soutenance devant un jury, se fait au cas par cas, à la carte, en tenant compte du contexte de travail et des difficultés spécifiques de chacun des stagiaires.
Les difficultés de compréhension des apports théoriques et de la production écrite dans un contexte de rapport aléatoire au temps et aux échéances, nous amènent à bricoler notre dispositif de formation pour l’adapter à notre public et à son contexte culturel.
Nous avons complété cette formation initiale par des sessions d’une semaine en psychomotricité, orthophonie, essentiellement axées sur la théorie, au service de la pratique au quotidien. Nous avons conservé le principe et les modalités de fonctionnement des groupes cursus. Les besoins sont importants ils sont directement au développement exponentiel au Sénégal de structures éducatives pour enfants déficients intellectuels.
Boris CHRISTMANN
Biographie
« La psychiatrie au pays des marabout » (2008) de Mr. AL Ousséne Dia.
Revue de « Psychopathologie Africaine vol 1 » (1965 ) de A. Zempleni et J. Rabain.
L’Afrique Monde sous la direction de Mr. Achille Mbenbe,
Mve Ondo Bonaventure
Tous les mots sont adultes (2005) de Mr François Bon